Amiante : du nouveau pour les travaux publics
L’Ineris a publié en octobre 2025 une étude inédite évaluant la toxicité pulmonaire des fragments de clivage d’actinolite, en les comparant aux fibres d’actinolite-amiante, dans un contexte de demande accrue de clarification réglementaire sur ces particules présentes dans les granulats et les matériaux de construction. Cette étude répond à une recommandation de l’ANSES visant à combler l'absence de données toxicologiques sur ces particules, potentiellement inhalables, issues de roches non-asbestiformes.
Le 29 octobre 2025
Étude comparative de la toxicité des fragments de clivage d’actinolite et de l’actinolite-amiante : quels risques respiratoires ?
Temps de lecture : 6 minutes – Catégorie : réglementation, toxicologie, innovation
L’Ineris a publié en octobre 2025 une étude inédite évaluant la toxicité pulmonaire des fragments de clivage d’actinolite, en les comparant aux fibres d’actinolite-amiante, dans un contexte de demande accrue de clarification réglementaire sur ces particules présentes dans les granulats et les matériaux de construction. Cette étude répond à une recommandation de l’ANSES visant à combler l'absence de données toxicologiques sur ces particules, potentiellement inhalables, issues de roches non-asbestiformes.
Un contexte sanitaire et réglementaire préoccupant
Bien que l’usage de l’amiante soit interdit en France depuis 1997, ses formes naturelles non asbestiformes (comme les fragments de clivage d’amphiboles, dont l’actinolite) restent présentes dans certains matériaux issus de carrières. Ces fragments, classés comme particules minérales allongées (PMA), présentent des similarités morphologiques avec l’amiante (rapport longueur/diamètre > 3), justifiant une analyse approfondie de leur potentiel pathogène.
Méthodologie de l’étude : un protocole rigoureux
L’étude menée par l’Ineris et le Centre de Recherche des Cordeliers (FunGeST) s’est concentrée sur des échantillons d’actinolite :
-
Fragments de clivage issus de Corse (fournis par le BRGM),
-
Fibres d’actinolite-amiante provenant de la mine de Salau (Pyrénées, via AD-LAB).
Les échantillons ont été rigoureusement caractérisés par MET selon les critères de l’OMS, et administrés à des rats via instillations intra-trachéales sur 10 jours. L’analyse des effets a été conduite à 24h et à 90 jours après exposition.
Résultats : des effets biologiques notables mais différenciés
1. Biopersistance
Les fragments de clivage présentent une biopersistance égale ou supérieure à celle de l’amiante (25 à 40 % de particules encore présentes dans les poumons après 90 jours, contre 20 % pour l’amiante). Ce paramètre est déterminant, car une persistance prolongée est corrélée à un risque accru de fibrose et de cancer.
2. Potentiel fibrosant
Les fragments de clivage entraînent une cytotoxicité pulmonaire persistante, mais induisent globalement moins de fibrose que les fibres d’amiante, notamment 3 mois après exposition, comme en témoigne la moindre induction du TGF-β, un marqueur clé dans la fibrose.
3. Potentiel cancéreux
Les deux types de particules ont généré des lésions histopathologiques et une inflammation pulmonaire, mais celle causée par l’amiante s’est révélée plus persistante. Les fragments de clivage ont induit une inflammation transitoire et un nombre accru de cellules apoptotiques, indicateurs d’un potentiel précancéreux, mais moindre que celui de l’amiante.
4. Voies de signalisation altérées
L’analyse transcriptomique a montré que les fragments de clivage partagent plus de la moitié des gènes différentiellement exprimés avec ceux activés par l’amiante. Toutefois, les dérégulations des voies de fibrose, d’inflammation, de vascularisation et d’immunité sont plus marquées avec l’amiante à 90 jours, ce qui renforce l’hypothèse d’une toxicité moindre mais réelle des fragments.
Conclusion : une alerte sur les fragments de clivage, à considérer réglementairement
L’étude conclut que les fragments de clivage d’actinolite ne sont pas inertes. Leur biopersistance, leur cytotoxicité, et leur impact sur les voies pulmonaires doivent conduire les acteurs réglementaires à considérer ces particules avec la même vigilance que les fibres d’amiante, notamment en contexte d’inhalation professionnelle (carrières, chantiers routiers).
Le tableau comparatif de synthèse (page 4) illustre clairement que si les effets sont moindres que ceux de l’amiante, ils restent significatifs et préoccupants, justifiant des recherches complémentaires (cancérogenèse, études à long terme, identification des seuils critiques).
Sources :
Pour en savoir plus et bénéficier de notre veille réglementaire et normative, nous consulter.
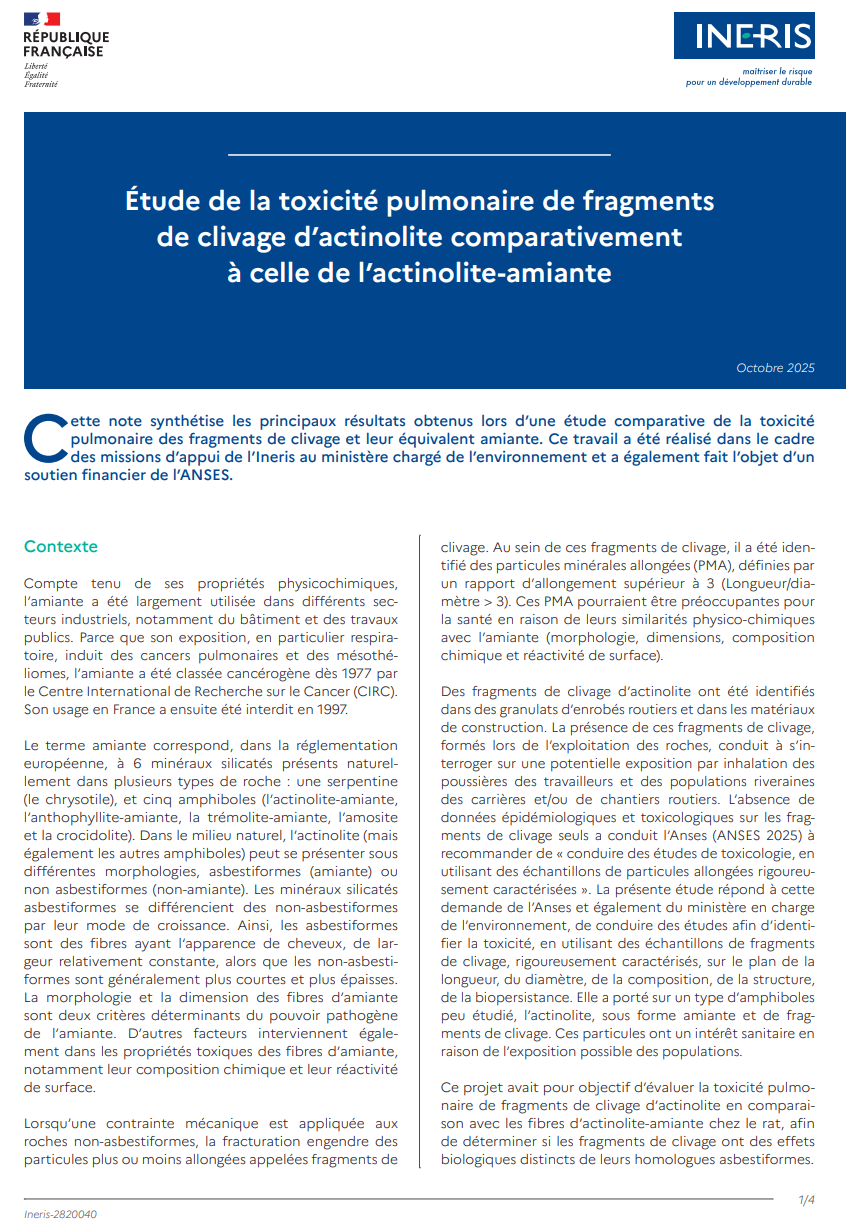
Management
du risque sanitaire
Parce que le pire est prévisible,
nous vous préparons pour le meilleur.

 France
France Espagne
Espagne